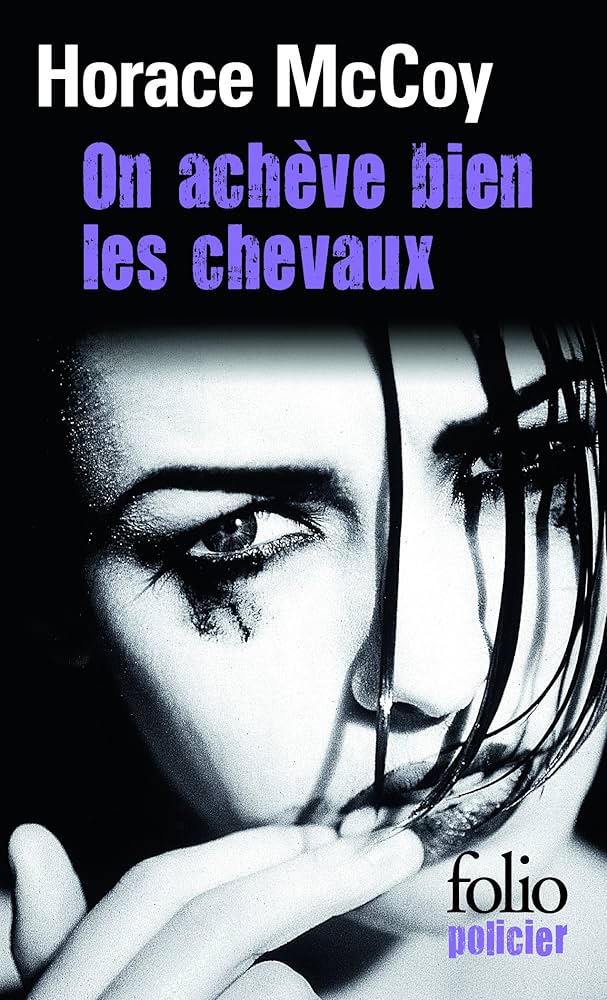
Nous sommes à Hollywood, en pleine crise des années 1930, avec deux personnages qui subissent de plein fouet cette époque : Robert, dont on suit le procès dans une trame secondaire du roman, et Gloria, orpheline, qui a échappé à maintes reprises aux institutions et tente de survivre dans une société impitoyable. Aspirant tous deux à faire du cinéma, Robert Syverten et Gloria Beatty, complètement fauchés, se lancent dans un marathon de danse dans l’espoir de remporter le premier prix : 1 000 dollars et, peut-être, des rencontres et opportunités dans le milieu du cinéma.
Horace McCoy illustre, à travers ce roman, l’absurdité de la société américaine en mettant en scène un marathon de danse où les couples doivent danser des heures durant, avec seulement 10 minutes de repos pour dormir et accéder à un buffet à volonté. Dans cet espace clos, une série de situations comiques et burlesques se déroule : certains participants croient dur comme fer à leur chance et prennent le concours très au sérieux, tandis que d’autres, comme Gloria, se montrent cyniques et désespérés, critiquant cette société du spectacle. Gloria devient, pour moi, la voix du lecteur, avec son humour acerbe et sa franchise déconcertante. Elle a le courage de dénoncer sa condition de quasi-esclave, contrainte de danser des heures sous peine d’être disqualifiée, avant d’enchaîner avec un « derby » quotidien, une sorte de course épuisante ajoutée au spectacle. Seule à réussir à verbaliser son désespoir, tantôt suicidaire, tantôt morbide, Gloria incarne une version féminine (et américaine) d’un Emil Cioran dans ses années les plus sombres.
Les organisateurs, en plus de bâtir leur popularité sur des faits divers liés au banditisme, font parader la haute société, qui observe ce spectacle tordu pendant les trois semaines du concours. Les participants, épuisés, s’évanouissent chaque jour, se gavent de nourriture gratuite lors des rares pauses, et sont même payés pour se marier en direct, ajoutant encore plus de spectacle au spectacle. Avec leurs sponsors et soutiens, nos pauvres protagonistes deviennent les instruments d’une société qui, pour oublier sa vacuité, réclame toujours plus de divertissement. À l’exception de Gloria, chaque personnage semble parfaitement intégré dans ce modèle, résigné face à la violence sociale et économique, voire physique, puisque plusieurs agressions et un meurtre se produisent au cours du concours. En plus de la critique sociale et politique, l’intrigue offre une dimension de polar bien ficelée, avec un plaisir coupable pour le lecteur, qui sait dès le début quel sort attend les deux protagonistes. Il reste aussi la magie de l’écriture de McCoy qui, avec peu de mots, parvient à planter un décor. Même si nous connaissons l’issue, certaines réactions et comportements des personnages nous demeurent incompréhensibles.
Horace McCoy fait partie de ces artistes marqués par la crise des années 1930 qui, avec un humour noir, révèlent l’avenir sombre d’une société où les classes populaires, la masse des précaires, n’ont pour seul exutoire que le divertissement (produit par d’autres précaires) pour accepter leur sort. Toujours tournés vers des idoles — vedettes, sponsors, grandes familles respectables — McCoy prend soin de décrire ces élites sans jamais leur attribuer directement la responsabilité des violences sociales, laissant planer l’idée que leurs mains ne sont jamais tachées.
Horace McCoy, On achève bien les chevaux, Folio Policier, 1999. Traduit de l’américain par Marcel Duhamel , 180 p.
A fine
Laisser un commentaire