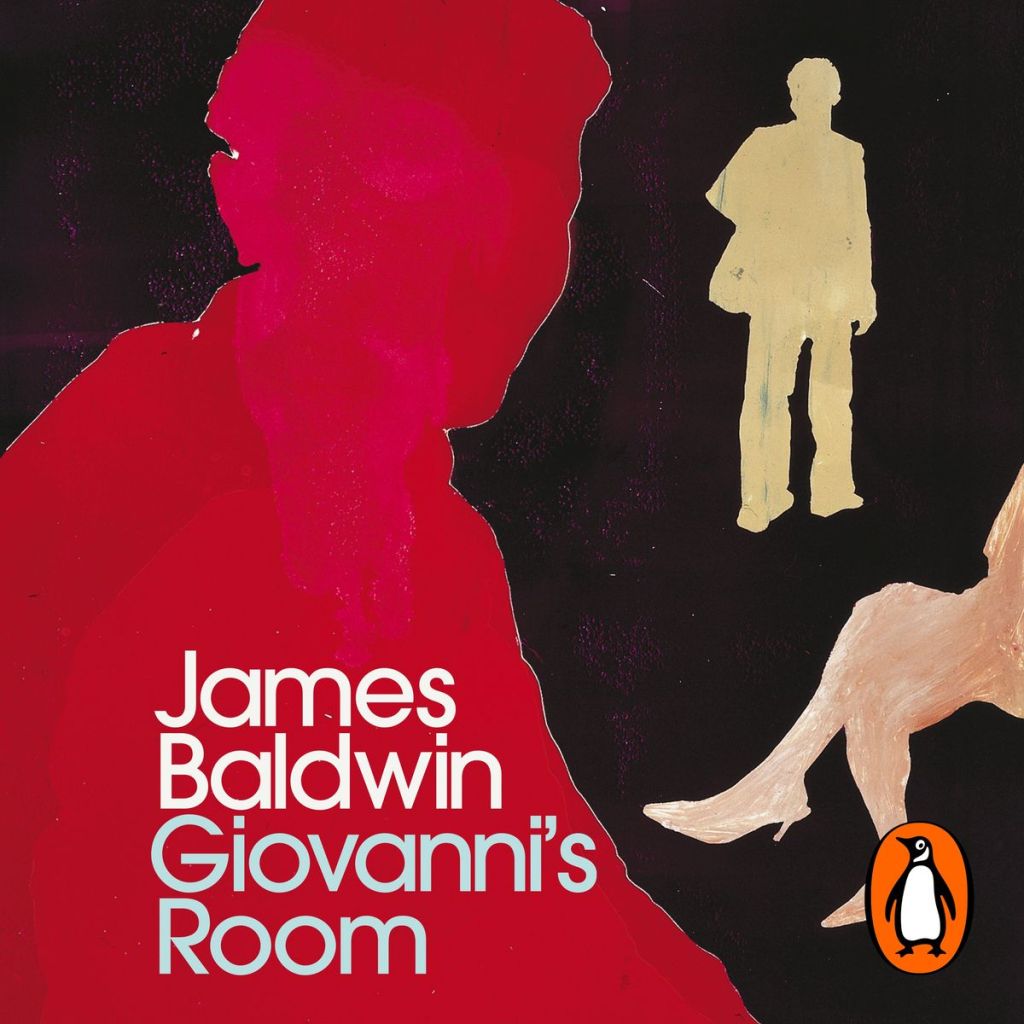
Après la mort tragique de sa mère et une adolescence quelque peu chaotique, David quitte les États-Unis pour s’installer à Paris, où il rencontre Hella, une jeune Américaine avec qui il décide de se fiancer. Lorsqu’elle part quelques mois en Espagne, David se retrouve seul, sans argent, entretenu par de riches hommes qui l’introduisent au monde underground queer parisien. C’est là, dans un bar, qu’il rencontre Giovanni, un barman italien avec qui il va entretenir une relation passionnée. C’est dans la chambre de Giovanni, mais aussi dans le Paris des années 1950, que se dessine cette aventure amoureuse et tragique, dans l’attente du retour d’Hella, revenue pour repartir avec David.
Grand activiste pour les droits des Noirs américains, James Baldwin choisit ici de raconter une histoire d’amour homosexuelle entre deux hommes blancs : David, Américain de culture WASP et d’extraction bourgeoise ; et Giovanni, immigré italien issu d’un milieu populaire. Ayant lu Baldwin en anglais, dans sa langue d’origine, je ne peux que recommander cette approche, ne serait-ce que pour savourer la beauté de ses descriptions et l’ambiance qu’il parvient à instaurer dans ce roman devenu emblématique dans la culture queer.
L’intrigue débute avec l’enfance et une brève adolescence de David, marquées par la perte de sa mère et la présence d’un père immature et alcoolique. Incapable de verbaliser son deuil ni de servir de modèle à son fils, ce père tente de faire de David son « meilleur ami », dans une dénégation totale de leur souffrance commune, comme des questions que se pose David sur son identité et sa place dans une société puritaine, hypocrite et fermée. À ce propos, je ne peux que conseiller au lecteur de franchir la première partie du roman, que j’ai trouvée particulièrement anxiogène et claustrophobe. Grâce à une langue à la fois simple et intensément incarnée, Baldwin m’a fait ressentir toute la torpeur de ce jeune David, confronté à l’injustice de son monde.
Ce n’est qu’à l’âge adulte, après avoir décidé de partir pour Paris, que le roman s’ouvre esthétiquement et socialement. J’appuie ici ma recommandation d’une lecture en anglais. Si le début du livre peut se lire en traduction, l’ouverture sur Paris est proprement magnifique dans la langue de Baldwin. Ce fut pour moi, qui ai longtemps pensé — comme beaucoup — que Paris appartenait esthétiquement aux auteurs français, une révélation. Dans la langue de Baldwin surgissent une tempête d’émotions, des descriptions d’une justesse rare, et une ville qui s’articule avec intensité autour des personnages.
C’est sans effort apparent que David glisse dans le monde underground gay parisien. À travers des hommes plus âgés, qui lui prêtent de l’argent contre un peu de compagnie, nous descendons dans des bars queer, cachés et encore illégaux à cette époque. Baldwin y dévoile une culture alternative, souterraine, en marge de la société normative d’hier — et d’aujourd’hui. C’est dans cet univers que David rencontre Giovanni.
Giovanni incarne l’anticonformisme. Immigré, constamment malmené, il contraste radicalement avec David. Alors que ce dernier représente l’homme occidental moyen — manipulateur, hypocrite, bourgeois, attaché aux apparences — Giovanni est le seul personnage véritablement sincère. Sincère dans le deuil de son ancienne vie, sincère dans la conscience de ses failles et de son désespoir, sincère surtout dans la relation qu’il construit avec David. Il est, en définitive, la vraie victime de ce monde brutal, machiste et homophobe, où il faut s’inscrire dans un système fondé sur l’exclusion pour espérer avoir une place.
Il faut également saluer le génie de Baldwin dans l’écriture des dialogues. Il retranscrit à merveille le double sens des mots et les tensions latentes. Je pense notamment à la rencontre entre David et Giovanni, l’un des moments les plus marquants du livre. Cette scène se joue sur un long échange, ponctué d’apparitions et de disparitions de Giovanni, découpant le dialogue en plusieurs actes et nous immergeant dans l’ambiance du bar. Peu à peu, Giovanni prend l’ascendant sur David. J’ai trouvé cela d’une grande force dans la manière dont c’est construit, amené, mis en rythme. On y retrouve cette « marginalité » littéraire de Baldwin : par la figure de Giovanni — moins instruit, plus pauvre — surgissent des éclairs de vérité, une lucidité du monde qui vient presque faire taire le narrateur.
L’autre parallèle que trace Baldwin apparaît dans la double exclusion du monde queer. Exclusion extérieure, puisqu’il faut vivre caché, toujours en proie à la violence homophobe de la société. Et exclusion intérieure, puisque des personnages comme Guillaume exercent une forme de torture psychologique sur Giovanni. Véritable figure du pervers, Guillaume reproduit la violence hétérosexuelle au sein même d’un espace supposément sûr pour les homosexuels. Le fait que les personnages soient constamment en train de boire, pour tenter d’accepter qui ils sont — et donc, en définitive, de ne jamais vraiment y parvenir — illustre aussi cette tension.
En cela, Giovanni « quitte ce monde » et apparaît comme le seul personnage à s’en sortir — paradoxalement, par la mort. Reste alors David, et ce que Winnicott appellerait son « faux self » : David et son homosexualité interdite, lui qui, à plusieurs reprises, aurait pu choisir autrement, mais s’acharne à maintenir un système où personne n’a de place, où la loi sociale écrase les individualités et interdit l’amour.
On peut aussi faire une incise sur le personnage de Hella, qui, en tant que seule femme avec la belle-mère de David, cherche, de ses propres mots, une place “de future mère”, “soumise” à l’homme et totalement passive. On peut noter l’ironie et l’humour de ce personnage, qui remarque — déjà avant l’heure — que son voyage en Espagne n’a fait que lui montrer d’autres hommes voulant profiter d’elle, simplement dans une autre langue que l’anglais ou le français. En cela, la révélation finale du livre lui permet d’accéder à une vérité, brutale certes, mais qui lui offrira peut-être, dans un avenir proche ou lointain, le choix de ne plus être un objet soumis aux lois masculines.
Je terminerai en disant que James Baldwin, en militant des droits civiques, offre ici un parallèle fort entre la condition des Afro-Américains et celle des homosexuels (ainsi que de toutes les autres minorités opprimées) : tous deux condamnés à vivre une ségrégation. Les uns dans un ghetto de briques, noyés dans un racisme permanent ; les autres dans ce que Santiago Amigorena appelle le ghetto intérieur — ce lieu désertique où, malgré quelques émotions ou gratitudes, la société décide qui est dans la norme et qui en est exclu. Et où, inévitablement, les mêmes causes engendrent les mêmes violences.
James Badlwin, Giovanni’s Room, Penguins collection Modern Classics, 176p.
A fine
Laisser un commentaire